-
Par ChristianeKolly le 6 Octobre 2018 à 13:20
Quand j'étais gamin, mon oncle Henri, mais oui celui qui voulait nous tuer, mon frère et moi, parce que nous avions chapardé quelques prunes, celui-là même avait deux passions : le football et le hockey. Je devais avoir huit ou neuf ans quand il est venu un jour à la maison me chercher pour aller voir un match de hockey à Gottéron1.
Me voilà embarqué dans sa bagnole. Nous sommes arrivés à la patinoire des Augustins, patinoire non couverte où quand il avait gelé et que la glace s'était formée, le match pouvait avoir lieu, mais si la température montait, au revoir pas de match. Dans ce quartier de l'Auge, quartier pauvre de la ville, les familles comptaient entre cinq et huit enfants qui avaient faim parfois, la pauvreté régnait. C'étaient des Bolzes. Aujourd'hui encore, les enfants de la Basse, ce sont les Bolzes. Ils allaient dans la forêt couper des branches. Ils assemblaient tant bien que mal deux ou trois bouts de bois pour fièrement devenir propriétaire d'une canne de hockey. Sur l'étang des Augustins, du nom d'un Couvent proche, les enfants, à force de jouer, de s'entraîner sans le vouloir, devenaient de vrais petits hockeyeurs. Le public affluait, puisque depuis Villaraboud même, à plus de quarante kilomètres de là, nous venions voir un match. La ville de Fribourg contente de voir ses enfants s'adonner à une activité saine, et des donateurs privés se sont mis d'accord pour construire une vraie patinoire, artificielle cette fois, pour les enfants de la Basse. Il ne fallait plus attendre qu'il gèle pour pouvoir jouer au hockey. Le club évoluait déjà en première ligue, ce qui représentait la troisième catégorie nationale, et les membres venaient tous de la Basse.
Deux ou trois ans plus tard, Fribourg Gottéron est monté en ligue nationale B. La nouvelle patinoire n'était pas couverte. Quand il neigeait vers dix heures du soir, le match était arrêté pour prendre le temps de balayer la neige, puis le match reprenait. Ainsi, certains matches duraient jusqu'à une heure du matin. C'était une équipe soudée, au dynamisme hors du commun, ils jouaient comme un seul homme sur la glace. Avec le temps, le club s'est structuré, avec comité, président, membres.
Après deux ou trois championnats en ligue B, les hockeyeurs ont si bien joué que le club est devenu premier de sa ligue, qualifié pour la finale où le premier de ligue B jouait contre le dernier de ligue A, le CP Zurich, en l'occurrence. Si Gottéron gagnait, il passait en ligue A et Zurich était relégué en ligue B. Par un froid de canard, à la patinoire des Augustins, toujours ouverte, j'ai assisté au match. Contre toute attente, nous avions l'espoir de voir gagner notre équipe, mais là, c'était l'euphorie générale, nous avons battu Zurich six à zéro.
La saga de Fribourg Gottéron a commencé à ce moment-là. Avoir battu Zurich, ça nous a donné des ailes. Avoir battu les suisses allemands, dans la Suisse romande, ce fut une sacrée victoire, puisque nous sommes en minorité, en Suisse il y a environ deux germanophones pour un francophone. Mais à Fribourg, canton majoritairement francophone, on compte deux Welchs2 pour suisse allemand. L'avantage pour le public a été que, pour jouer en ligue A, il fallait disposer d'une patinoire couverte. C'est comme cela qu'une bâche jaunâtre a été montée sur les Augustins.
Le succès allait grandissant, ce qui faisait que, pour assister à un match, il fallait arriver à quatre ou cinq heures de l'après-midi pour s'assurer de trouver une place pour le match qui débutait à huit heures et demie le soir, sans parler des embouteillages et des difficultés à trouver une place de parc, dans cette Basse-ville aux maisons serrées, aux rues étroites reliées par des ponts sur les méandres de la Sarine, aux falaises impressionnantes. Mais l'oncle Henri y tenait tant qu'il disait à son domestique de traire ses vaches. Nous partions à trois heures et demie quatre heures, sûrs ainsi de trouver une place. L'oncle Henri prenait le viatique, histoire aussi de passer le temps en attendant le match. J'ai vu des supporters manger la fondue, assis sur les gradins des Augustins, par grand froid.
Je peux vous dire que quand Gottéron gagnait, les bistrots de la Basse restaient ouverts toute la nuit et que, du Tirlibaum, nous on disait Tirliboum, un café de la Place du Petit-Saint-Jean, jusqu'à la Pinte des trois Canards, dans la Vallée du Gottéron, tous les établissements étaient bondés, de la bière, encore de la bière, toujours de la bière.
Il y eut un combat d'arrière-garde. Ceux de la Basse voulaient garder leur patinoire en Basse-ville et les autres voulaient construire une patinoire plus accessible. Finalement, les premiers ont dû se résigner, le club avait pris une telle importance qu'il était impossible de le garder chez eux. C'est à Saint-Léonard, sur la route en direction de Granges-Paccot qu'une nouvelle patinoire a été construite. Il fallait aller "en-haut", au début ça a un peu coincé, mais finalement les Bolzes, fiers de représenter leur canton, ont accepté qu'on leur pique leur bébé. Petit Gottéron était devenu grand. Jouer dans la cour des grands comme Davos, Ambri Piotta et autres, il leur a fallu du temps pour réaliser qu'ils étaient devenus grands.
Il faut relever que, depuis leur arrivée en ligue nationale A, Fribourg Gottéron est la seule équipe nationale qui n'ait jamais été reléguée, même si parfois ça a été sur le fil du rasoir.
Un événement a quelque peu changé le visage de Gottéron, un article paru dans un journal suisse allemand disait que l'équipe nationale de Russie où les joueurs étaient jusqu'ici contraints à rester chez eux était désormais disposée à laisser partir quelques joueurs. Ils étaient à l'époque champions du monde et champions olympiques. Les journalistes russes ont pris contact avec les responsables des principaux clubs de hockey suisses. Ils ont tous refusé l'offre, ils avaient dans leurs rangs des canadiens ou des américains, ils n'étaient pas intéressés par des joueurs russes. Je fréquentais le club avec assiduité, mais encore dans l'anonymat. Le Président de Gottéron de l'époque, Jean Martinet, vint un soir vers moi :
- Tu as entendu parler des russes ?
- Oui, bien sûr !
- Et tu en penses quoi ?
- Il faudrait voir !
- Et bien, écoute-moi, la semaine prochaine, on part à Moscou, en Russie ! Tu veux venir ?
- Tu penses bien que oui, je ne voudrais manquer cela pour rien au monde.
Par chance, Martinet avait une fille qui travaillait chez Kuoni, agence de voyages à Fribourg, ce qui a facilité les démarches. Nous étions quatre et avons payé nos billets nous-mêmes. Et nous voilà partis pour le pays des slaves. Nous avions rendez-vous avec un certain Tikonoff de la Sbornaja, l'équipe nationale de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Arrivés en face de cet homme, le problème c'était la langue. Martinet dit :
- Swiss Captain !
- ...
Visiblement, il nous fallait une interprète. L'ayant trouvée, nous avons pu commencer les négociations. Martinet dit :
- Il nous faut un ailier droit !
C'est là qu'il fait venir Andrei Khomutov. Celui-ci nous dit, c'est comme ça les russes, qu'il était d'accord pour s'expatrier, mais à condition de venir avec son copain Viatcheslav, dit Slava Bykov. D'entrée, Martinet n'était pas très chaud, il n'en voulait qu'un. Nous l'avons convaincu qu'il était préférable pour tout le monde d'engager les deux : ils joueraient mieux, ils s'ennuieraient moins. Le transfert de deux des meilleurs joueurs de la planète a coûté au Club Fribourg Gottéron un autocar que les russes voulaient pour se déplacer quand ils allaient jouer à l'extérieur. Nous avons fait fabriquer l'autocar en Tchécoslovaquie, il pouvait contenir septante personnes, il était magnifique. C'était notre contribution pour le club, le prix du transfert.
Quant à nos deux vedettes, Khomutov et Bykov, leurs salaires étaient de dix mille francs par mois, nets d'impôts, un logement et une voiture. Comparés aux salaires des joueurs canadiens ou américains, nous faisions vraiment une belle affaire. Les russes sont arrivés et ont été installés à Marly, dans une villa jumelée, l'un à côté de l'autre. Leurs femmes respectives les accompagnaient, celle de Khomutov se prenait pour une diva et a tout de suite grimpé dans l'échelle sociale, manteaux de fourrure, bijoux et autres signes extérieurs de richesse alors que la femme de Bykov était une personne réservée et fort aimable.
Je faisais alors partie du comité de Fribourg Gottéron. C'est là que s'est joint à nous mon incontournable ami Jean-Marie Dévaud, dit Nanet :
- Il faut faire quelque chose pour Gottéron ?
- Quoi, tu veux faire quoi, de quoi tu parles ?
- En basse saison, il y a toujours ce problème de liquidités. Il faut trouver un moyen d'aider le club pour faciliter ce passage et payer les joueurs quand le club n'encaisse pas de recettes.
CCH est né, coopérative de cautionnement du hockey. Nous étions solidaires auprès de la banque, à titre privé, à raison de quarante mille francs par personne, ce qui faisait quatre cent mille francs à disposition du club pour payer les joueurs en basse saison. Notre contribution en liquide se montait à quatre mille francs par personne et par année pour les frais de la loge et les frais de déplacements. Plus tard, le nombre d'adhérents a passé à quatorze. Nous avions à notre disposition une loge et pour les femmes quatorze places assises, nous voulions regarder les matches entre hommes. Durant la pose, nos épouses ou partenaires respectives venaient prendre un verre dans notre bar, mais dès que la partie reprenait, elles regagnaient leurs places.
Le système a bien fonctionné et vu le nombre de membres, nous avons fondé un comité. Nanet, vu ma facilité d'élocution pour ne pas dire ma grande gueule, m'a propulsé Président, lui s'occupait des finances. C'était grandiose. Très souvent, Francis Mauron, Président de CCH, était invité à se rendre au milieu de la patinoire, devant tout le public, pour remettre une montre ou un autre prix au meilleur joueur de chaque équipe. J'ai fait cela durant deux ou trois ans. Mais un jour, la Banque de l'État nous a envoyé une lettre nous informant que, le Club de Fribourg Gottéron n'étant plus capable d'assumer ses dépenses, nous étions invités, selon l'acte de cautionnement que nous avions signé, à payer la somme de six cent cinquante mille francs. Il fallait débourser chacun plus de quarante-six mille francs. Nous avons été convoqués, à six heures et demie du matin, à la Fiduciaire Baudet à Fribourg, présidée par Gaston Baudet, un homme qui avait de nombreuses relations dans le milieu de la finance et qui tenait les comptes de Fribourg Gottéron. Il y avait là un représentant de la Banque et un Conseiller juridique, Maître Sallin. Au début, il semblait que nous allions devoir passer à la caisse. En allongeant la discussion, nous avons constaté que la Banque avait autorisé elle-même le dépassement du crédit fixé à la base à quarante mille par cosignataires. La dette réelle du club se montait à sept cent huitante mille francs. Même le Président du Tribunal, Monsieur Esseiva, arrivé un peu plus tard dans la journée, a confirmé qu'au point de vue juridique, l'action était irrecevable, c'était la Banque qui était fautive. Nous étions soulagés et heureux...
Après cet incident qui a bouleversé fortement certains membres, le CCH a été dissout. C'est là que la fameuse campagne "Il faut sauver Gottéron" avec manifestations et tapages en tous genres a porté ses fruits puisque la situation financière du club a été assainie durant quelques temps.
Pour revenir au fonctionnement de CCH, nous avions créé des statuts, dont l'un des articles vaut le détour : l'assemblée générale de la coopérative avait lieu une fois l'an à Moscou. Nous étions une équipe, provenant principalement du domaine de la construction et des bâtiments, une équipe de noceurs. Première assemblée générale, vol pour l'URSS en business classe, il y avait Conrad du Lion d'Or, les Ropraz Entrepreneurs, Doudou des Ascenseurs. Nous étions logés à l'Hôtel Baltschug Kempinski, s'il vous plaît, un cinq étoiles en face du Kremlin avec Saint Basile, ses dorures et ses tours. En tant que Président, j'ai même eu droit à une chambre plus grande que les autres, une petite suite qui donnait sur deux rues, avec trois fenêtres d'un côté, trois fenêtres de l'autre. Jean-Marie était déjà venu en repérage, je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Quand le soir est arrivé, que font les hommes seuls dans une grande ville réputée pour ses belles femmes ? Il fallait trouver le Ni Flè, disait Nanet. En vérité, le nom de l'établissement était Night Flight, vol de nuit, mais Antoine de Saint-Exupéry n'y avait certainement plus grand chose à voir. Les poupées russes, nombreuses, des secrétaires ou des étudiantes, acceptaient quand même, pour cent cinquante ou deux cents dollars de venir dormir avec un homme, surtout au Baltschug Kempinki. Trois ou quatre jours, il nous les fallait pour une assemblée générale, le temps de visiter les lieux, de se faire plaisir.
Un soir, j'étais vraiment sur les rotules, j'avais décidé de ne pas sortir, de rester en chambre. Après quelques heures de sommeil, je me suis réveillé et le bar de l'hôtel devait être encore ouvert. Je suis descendu et j'ai demandé au barman :
- N'avez-vous pas de dames de compagnie ?
- Non, non, non, voyons, nous sommes un établissement respectable. Pas de cela ici.
- Réfléchissez-y !
C'était deux heures du matin. J'ai quitté le bar et après trois marches vers l'ascenseur, j'ai aperçu une femme, manteau de cuir noir, col relevé ... aïe ... le téléphone arabe, enfin russe avait dû fonctionner très rapidement. J'ai passé la nuit avec mon inconnue. J'ai même oublié la protection habituelle dans le feu de l'action. Heureusement, test à l'appui une fois rentré, il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Mais le matin, elle s'incrustait ! Nous avions une réunion à dix heures, il fallait qu'elle s'en aille. Finalement, elle est partie, ouf !
1Le Gotteron (ou Gottéron, appelé en allemand Galtera ou Galternbach), qui signifie "chaudron" et désigne une vallée encaissée en franco-provençal, est un cours d'eau de Suisse qui traverse une partie du canton de Fribourg. La rivière Galtera prend sa source au nord de la commune d'Oberschrot, s'écoule vers le nord puis l'ouest dans l'étroite vallée nommée Galterengraben flanquée de falaises qui, depuis le Moyen-Âge, abritait des moulins et des martelleries. Environ un kilomètre avant de se jeter dans la Sarine (bassin du Rhin), à l'entrée de la ville de Fribourg, la rivière et la vallée prennent le nom de Gotteron, source Wikipedia
2En Suisse alémanique, le terme de "Welch" désigne les habitants de la partie francophone suisse
Tiré du livre de Francis Mauron Le dernier chantier
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 14 Juin 2015 à 08:19
Le dernier chantier
Cliquer ici pour commander Prix : CHF35.00 (HT)Expédié en 3 à 5 jours ouvrésLa vie d'un homme hors du commun, qui aimait les lettres, mais qui pour obéir à son père a été maçon, puis conducteur de travaux pour finalement devenir architecte. Bon compagnon pour les hommes, avec le poker, le hockey à Gottéron, la foire et les boîtes de nuit, inconditionnel des dames. Il aimait aussi les voyages. votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 7 Novembre 2014 à 21:10
Après mon divorce avec Éliane, redevenue Sulmoni, j'avais le blues. À l'agence Kuoni à Fribourg, qui me proposait Bali ou la Thaïlande, j'ai dit non, je voulais retourner aux États-Unis. J'avais aimé ce voyage en Floride avec Éliane, je voulais y retourner, mais pourquoi, je ne savais pas encore. C'est comme cela que je réserve un billet pour New-York, Big Apple, auprès de la compagnie TWA, Trans World Airlines, aller et retour, validité un mois.
Il fallait quand même prendre des dispositions. Je vais vers mon chef de bureau, Jean-Marc Roulin, pour lui demander de s'occuper des affaires courantes durant mon absence. Il a été surpris et un peu apeuré, mais finalement, rassuré, il a accepté de le faire, avec la secrétaire. Il n'y avait pas de "casseroles sur le feu", ce n'était pas une tâche bien difficile.
Il fallait maintenant aller voir mon père, pour l'entreprise !
-
Écoute François, je pars un mois !
-
Tu es toujours le même inconscient ! Tu divorces et maintenant tu veux partir !
-
Oui, j'ai besoin de changer d'air.
-
Mais quand même, et l'entreprise, l'entreprise, l'entreprise !
-
Tu n'es pas bien vieux, tu es encore capable, en forme, il n'y a pas de problèmes ! Tu vas rediriger TON entreprise!
Il me regardait bizarrement, béatement, mais il y avait une étincelle dans ses yeux, il allait redevenir le chef de l'entreprise.
-
Bon, après tout, d'accord. Je vais le faire. Ne fais pas l'idiot là-bas.
Les quelques travaux en cours n'allaient pas lui demander de bien gros efforts, ça tournait bien, c'était bien organisé. Il l'a fait avec un plaisir un peu dissimulé.
Le bureau, c'était réglé, l'entreprise, c'était réglé, il restait l'argent. Je ne pouvais pas partir sans fonds. J'avais déjà une carte de crédit American Express, la meilleure carte que j'aie jamais eue, très avantageuse et connue pour les titulaires, mais cher payé pour ceux qui l'acceptent, six ou sept pour cent de frais.
J'ai acheté pour dix mille dollars de travellers chèques, cent chèques à cent dollars. Il valait encore trois francs cinquante, ça faisait une belle somme.
Je prends ma bagnole, la laisse au parking souterrain de Zurich Kloten où j'avais négocié au préalable un contrat de location pour un mois, payé d'avance ... et si je ne revenais pas ? Tant pis !
J'embarque, vol tranquille, et me voilà à New-York, aéroport Kennedy. Je me rends en taxi au Waldorf Astoria où une chambre avait été réservée. Magnifique, grandiose, les hauteurs, les lustres, les dorures, c'était extraordinaire. Il était cinq heures de l'après-midi, heure locale. J'ai rangé mes belles affaires, costards, cravates, le tout bien ordonné, bien en place.
Vers huit heures, je descends au bar et commande un Chivas Regal, puis un deuxième. Ça voulait dire que j'avais du goût pour le bon whisky, à la mode à l'époque et que j'avais les moyens de me le payer, un homme considérable et considéré. Je me mets à parler avec la barmaid, une grande blonde à la robe rouge, avec mon anglais trébuchant.
Un peu plus tard, je me rends au dining room, tout seul, et là je réalise que je m'ennuie, je m'emmerde, je me languis, je ne trouve pas du tout cela drôle. Je n'allais pas passer beaucoup de temps à me morfondre de la sorte, il fallait que je trouve quelque chose. Le lendemain, j'ai dormi toute la journée, fatigue du voyage, lâcher de stress. Le soir, je retourne au bar de l'hôtel et je refais la même chose que la veille, un Chivas, deux Chivas ... C'est là qu'arrive un homme, à ce bar, bel homme, bien de sa personne, mon âge à peu près.
-
Vous parlez français ?
-
Oui, je suis français, je suis breton !
-
Ça tombe très bien parce que nous, les Mauron, nous sommes originaires de la Bretagne, un petit village du sud de la Bretagne, Mauron.
-
Ah tiens, c'est étrange, je le connais ce village.
-
Moi non, je n'y suis jamais allé. Et vous êtes seul ici ?
-
Oui, je suis venu changer d'air ... à cause d'une femme !
-
Ah tiens, moi aussi !
-
Bon, c'est bien, points communs.
-
On va faire quelque chose ensemble si vous voulez, ce serait plus sympathique que seul ?
-
Oui d'accord.
Il s'appelait Guy Queinnec. Après avoir fait schmolitz1, je lui dis :
-
Tu es d'accord, demain on va à Harlem ?
-
Non mais ça va pas, on va se faire tuer !
-
Rien du tout, j'ai un copain qui m'a expliqué. Tu mets tes jeans les plus usés, s'il n'y a pas de trous dedans, tu en fais, un chemise limée aux coudes, grande ouverte, tu enlèves tes bijoux et te voilà prêt pour Harlem.
-
Bon d'accord.
Nous avons pris un taxi et nous voilà à Harlem. Il n'y avait pas beaucoup de blancs, mais des noirs, des latinos, plus ou moins foncés. On se promène un peu et soudain on arrive devant un colosse, étalé de tout son long, deux mètres au moins, en travers sur le trottoir.
-
On passe par-dessus ?
-
Non jamais, fais attention !
-
Mais pourquoi ?
-
On m'a expliqué, il faut le contourner.
C'est ce que nous avons fait et je me suis retourné et j'ai vu une paire de gros yeux noirs qui m'observaient. Il m'a fait un gros sourire.
-
You are a good guy, I will offer you a beer – tu es un bon type, je t'offre une bière. Say it to your friend too – dis-le à ton copain aussi.
Nous sommes allés au troquet le plus proche et notre ami a commandé trois bières. Il était très content, il s'était rendu compte que nous avions eu du respect en n'enjambant pas son corps. Nous avons bu deux ou trois bières, en bons copains d'un petit moment. Il nous a montré des boîtes, des endroits où les touristes n'allaient jamais. Nous avons bu des bières toute la soirée et puis nous sommes rentrés à l'hôtel.
-
Alors, Guy, ça t'a plu le bronx ?
-
Oui, oui, c'était fantastique, on y retourne demain ?
-
Mais non, une fois c'est bien, mais ce n'est peut-être pas tous les jours comme ça ! Il faut passer à autre chose !
-
Bon d'accord, tu proposes quoi ?
-
Tu as du fric, Guy ?
-
Oui j'ai du fric !
-
Et bien moi aussi ! Tu as combien ?
-
Bon écoute, c'est un peu délicat comme question, mais disons que dépenser dix, quinze mille dollars, ça ne me pose pas de problèmes.
-
Bien. Tu as déjà entendu parler de la Road 66 ? La route 66 ?
-
C'est quoi ?
-
C'est la route qui va de Chicago dans l'Illinois à Santa Monika, Californie, à côté de Los Angeles.
-
C'est long ?
-
Oui, ça fait plus de deux mille miles, entre trois mille et trois mille cinq cents kilomètres, les États-Unis d'est en ouest.
-
On fait comment ?
-
On prend un billet d'avion pour Chicago et puis on achète une voiture.
-
D'accord.
Nous avons pris l'avion à La Guardia, aéroport principalement interne des États-Unis, aller simple pour Chicago. Arrivés sur place, nous sommes entrés dans le premier hôtel que nous avons vu. Rapidement, nous nous sommes rendus dans le premier garage pour acheter une voiture, une Chevrolet Impala noire, avec des ailes si hautes qu'elle aurait peut-être pu s'envoler. Elle était magnifique, rutilante, elle coûtait trois mille dollars.
-
C'est cher ! me dit Guy.
-
Ne t'inquiète pas, nous la revendrons de l'autre côté.
Nous avons reçu notre belle auto, avec les plaques, et sommes partis à l'aventure, vers "The road 66", la route 66.
Premier soir, premier motel, on s'arrête à gauche de la route, ambiance sympathique, mais disons modérée, nous avons mangé notre premier "chili con carne"2 avec une bonne bud, l'excellente bière Budweiser et nous sommes allés nous coucher. Nous faisions trois cents kilomètres par jour environ. Le lendemain, nous sommes repartis. Plus on avançait et plus c'était intéressant, il y avait des échoppes le long de la route, tous les cents mètres, il y avait quelque chose à acheter. Après deux ou trois jours, c'est devenu vraiment plus intéressant, des hippies envahissaient cette route 66. C'était la fin de la guerre du Vietnam, la mode du "peace and love"3, les filles étaient en fleurs, elles avaient des bandeaux dans les cheveux et des bracelets aux chevilles. Durant sept ou huit jours, nous avons vécu une période extraordinaire, à la bonne franquette, tout le monde se souriait, tu veux venir coucher avec moi, d'accord, tu ne veux pas, ça ne fait rien, d'accord aussi. Il n'y avait pas de jalousie, personne n'appartenait à personne. Chacun faisait ce qu'il voulait, chacun couchait avec qui il voulait. Nous sortions un peu de la route, quelques miles, pour passer des journées heureuses avec nos amis hippies, au bord des lacs, tous ensemble, à se faire plaisir.
Toutes les bonnes choses ont une fin, dit l'adage. Nous sommes arrivés à Santa Monika. Nous avons revendu la voiture deux mille dollars. La benzine nous a coûté trente-cinq centimes suisses le gallon de deux litres et demi. Il fallait rentrer à New-York pour reprendre l'avion. Il fallait rentrer à la maison, après avoir passé une dernière nuit au Waldorf Astoria à New-York.
Je n'ai jamais revu ni entendu parler de mon ami Guy Queinnec. C'est la vie.
1Passer au tutoiement en buvant un verre cul sec
2Plat à base de viande de bœuf et haricots rouges
3"Paix et amour" signe de reconnaissance des hippies entre eux
 votre commentaire
votre commentaire
-
-
Par ChristianeKolly le 3 Juin 2014 à 12:44
C'est lors d'un de ces voyages au Brésil, qu'il m'est arrivé une aventure peu commune. Un type m'interpelle un jour au bar Hollywood.
• You are Roger Moore ? Vous êtes Roger Moore ?
• No I am not, but why ? Non, mais pourquoi ?
C'est là qu'il m'explique qu'il avait un vieil oncle qui ne voyait plus très clair et qui avait bientôt huitante ans. Son idole, c'était Roger Moore. Il me propose d'aller voir son oncle à Buenos Aires en Argentine. L'homme était généreux en tournées au bar, mais aussi bien éduqué et il me semblait digne de confiance. Le lendemain matin, il me téléphone dans ma chambre, il n'avait pas renoncé à son projet. Il avait réservé un billet d'avion. J'ai pensé, bon, si c'estpour faire plaisir à un vieil homme, pourquoi pas, après tout, le goût de l'aventure, toujours le goût de l'aventure.
Nous avons pris l'avion à treize heures, destination Buenos Aires. Une voiture nous attendait à l'aéroport. Il devait être fort riche. Confirmation lorsque nous sommes arrivés dans une superbe propriété, avec une belle demeure et desdomestiques dans tous les coins. C'était le soir, il m'avait montré ma chambre. Après le repas, vers onze heures, je devais faire ce pourquoi j'étais venu, aller voir l'oncle qui ne savait, selon le neveu, que quelques mots d'anglais.
L'oncle m'a reçu dans un petit salon, autour d'une table ronde, des tableaux au mur. Il était petit, ratatiné même, à première vue pas loin de la capitulation. Heureusement, le neveu est venu aussi, au cas où il aurait fallu rattraper une maladresse de ma part. Grands sourires de part et d'autre, café, cognac, cigare. Je m'en suis bien sorti, l'oncle n'y a vu que du feu et de la paille de fer, en tout cas c'est ce qui m'a semblé. Le lendemain, nous sommes retournés à Rio.
Quand j'ai raconté l'histoire à Jean-Marie et André, ils n'ont pas voulu me croire. Ils étaient persuadés que j'étais avec une gonzesse et que j'avais voulu m'éclipser une journée. Et pourtant, j'étais bel et bien allé rendre visite à l'oncle de l'argentin en tant que Roger Moore, celui à qui je rêvais de ressembler depuis longtemps.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 4 Avril 2014 à 12:59
 J'ai connu Joseph Siffert lorsqu'il était apprenti carrossier chez Bianchi à la basse ville1 à Fribourg. Quand j'étais apprenti maçon, à dix-sept ans, j'allais aux cours pratiques dans un bâtiment situé à côté de la Carrosserie Bianchi. En passant régulièrement devant, un jour on s'est salué. Un autre jour, on est allé boire une bière au café de "La Clef" à la Neuveville, un des quartiers de la basse. C'est là qu'il m'a dit :
J'ai connu Joseph Siffert lorsqu'il était apprenti carrossier chez Bianchi à la basse ville1 à Fribourg. Quand j'étais apprenti maçon, à dix-sept ans, j'allais aux cours pratiques dans un bâtiment situé à côté de la Carrosserie Bianchi. En passant régulièrement devant, un jour on s'est salué. Un autre jour, on est allé boire une bière au café de "La Clef" à la Neuveville, un des quartiers de la basse. C'est là qu'il m'a dit :- Moi, je veux faire des courses de voiture !
- Ah oui, c'est une bonne idée !
- Oui, mais j'ai un problème, mes parents ne sont pas riches et pour réaliser ce que je veux faire, j'ai besoin d'argent.
Il a quand même trouvé le moyen de commencer avec une moto. Il faisait de petites courses, il était bon, il gagnait de petits trophées. Mais ce qui l'intéressait, c'était les voitures. Alors, avec deux ou trois copains mécaniciens, ils ont "bricolé" une bagnole de course qui avait les caractéristiques d'un véhicule junior. Il a voyagé, en France, en Italie, mais en Suisse, il n'y avait pas grand chose. Il a gagné quelque argent. L'équipe était formée, au hasard la chance. En Italie, il a gagné une course. Il commençait à se faire un nom dans la discipline. C'est là qu'un des fils Blancpain, à l'époque famille propriétaire de la Brasserie Cardinal de Fribourg, s'est pris de passion pour les courses de voiture, heureux de connaître et de pouvoir aider un as du volant. L'enthousiasme de Jo était communicatif et grâce à cette aide, il est devenu coureur automobile professionnel. Formule 3, formule 2, formule 1, cette fois, Jo jouait dans la cour des grands. Qui dit professionnel dit grands prix, je voyais mon copain à la télévision.
Jo était devenu célèbre dans le domaine et ses affaires allaient si bien qu'il a construit une halle pour ses bagnoles à Villars-sur-Glâne, en face du Café du Moléson, endroit que je fréquentais. On se voyait, assez souvent. Un jour il me dit :
- Mon prochain grand prix, c'est le grand prix d'Autriche, à Zeltweg, dans le sud du pays pas très loin de la frontière slovène. Si tu veux, je t'invite ?
- Ah oui, mais on fait comment ?
- Ne t'inquiète pas, tout est réglé, nous allons voyager en train. Nous irons jusqu'à Oerlikon en voiture et puis nous prendrons le train.
C'est ainsi que je me suis retrouvé dans un wagon à bestiaux, aménagé pour la circonstance, une grande table au milieu, des chaises, une trentaine de chaises pour une trentaine d'accompagnants. De sept heures du soir, c'était le vendredi, à dix heures le lendemain, nous avons parcouru les six cent cinquante kilomètres en buvant des bières et en rigolant beaucoup et dormant peu. Jo avait une couchette, il fallait bien qu'il se repose, les essais avaient lieu le samedi, et la course le dimanche. Après les essais, notre ami était bien placé, quatrième ou cinquième. Et le dimanche, c'était la course, à quatorze heures, les courses de formule 1, le départ c'est toujours à quatorze heures GMT (Greenwich Mean Time en anglais). Jo roulait avec une BRM2. Au début, il était un peu à la traîne, mais petit à petit, il gagnait du terrain, dépassant ses adversaires les uns après les autres. Et Jo a gagné la course, c'était en mille neuf cent septante-et-un. Belle heure de gloire que j'ai eu la joie de partager avec lui.
La même année, notre Jo national participe aux Vingt-quatre heures du Mans. Oui, il aimait les courses d'endurance, spécialement la plus grande. La course a commencé à seize heures le samedi, il partageait le job avec un pilote anglais, Derek Bell. Durant les trois premières heures, Jo était en tête, il fallait à tout prix essouffler les autres participants. Mais à onze heures du soir, lui et sa Porsche étaient essoufflés et la course abandonnée.
Un jour, je lui dit :
- J'ai envie de changer de voiture.
- Mais tu roules sur Mercedes, c'est une voiture de grand-père.
- Tu me proposes quoi alors ?
- J'ai là une voiture pour toi, une Dino Ferrari, du nom du fils de Enzo Ferrari.
- Ah bon, et je peux l'essayer.
- Viens la semaine prochaine, je suis au garage, je te la montrerai.
La semaine suivante, j'arrive au garage. Jo me dit :
- Bon Francis, maintenant, on va voir ce que tu sais faire !
- Oui, avec joie !
Il avait dans son garage une Shelby Cobra 7 litres, une puissance de moteur qui impressionne.
- Écoute Francis, j'ai un petit garage au Mouret, prends cette voiture et conduis-la jusqu'au Mouret.
Je n'étais pas peu fier. Monter la Crausaz3 avec ce bolide, je me voyais déjà piloter avec Jo. Mais, en arrivant :
- Francis, je dois te dire, tu ne sais pas conduire.
- Comment ça ?
J'étais quand même un peu vexé.
- Ben alors, on fait quoi ?
- Et bien maintenant, on redescend et je vais te montrer comment on conduit.
C'est vrai qu'il a fait le même trajet en la moitié moins de temps que moi. Belle leçon de conduite et d'humilité.
- Dis-moi, cette Dino, tu la veux ? C'est du feu Ferrari, tu es sûr que tu la veux ?
- Fais-moi une proposition.
- Trente-six mille, c'est le prix de la Dino, je te donne dix-huit mille de ta Merc, tu me donnes dix-huit mille et tu as la Dino ?
- D'accord.
Deux jours plus tard, je me pavanais au volant de ma Dino Ferrari, s'il vous plaît. Mais ce ne devait pas être une voiture pour moi. Elle tombait en panne à tout bout de champ, à un feu rouge, en milieu de ville. Jo regardait, réparait, mais après trois ou quatre mois, je m'en suis séparé.
Jo Siffert a couru aux États-Unis, les douze heures de Sebring après avoir fait six heures d'endurance au Japon, sans avoir dormi, décalage horaire oblige. C'était un mordu, un cinglé de la vitesse. Un jour, c'était un dimanche, au volant de ma voiture, j'entends à la radio que Jo était mort, c'était le vingt-quatre octobre mille neuf cent septante-et-un sur le circuit de Brands Hatch à Longfield en Angleterre, il avait brûlé vif dans sa voiture. J'étais très peiné. Trois jours après, je me suis rendu à l'enterrement. Du Pont de Pérolles, là où se trouve l'École d'ingénieurs jusqu'à la Cathédrale, il y avait tant de monde que quand le cercueil a atteint la Cathédrale, les derniers participants n'étaient pas encore partis du Pont de Pérolles. Plus de cinquante mille personnes voulaient rendre hommage à l'enfant du pays devenu une icône nationale. Il est enterré à Saint-Léonard, au cimetière de Fribourg.
Son fils Pierre Siffert a tenté une carrière de pilote, mais comme il n'avait pas le gabarit de son père, il a rapidement abandonné.
1La "Basse", c'est des églises et couvents, des ponts sur la Sarine, des fontaines, mais aussi une culture populaire, le "Bolze"
2British Racing Motors (BRM) est une ancienne écurie de sport automobile britannique, présente en Formule 1 de 1951 à 1977, source Wikipedia
3Lieu-dit, réputé pour ses longs virages
Jo Siffert
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 8 Mars 2014 à 07:56
 J'y ai cru à ce pays, cette contrée miraculeuse, ce paradis terrestre où fêtes et bombances sont perpétuelles, où l'on prône le jeu et la paresse plutôt que le travail acharné.
J'y ai cru à ce pays, cette contrée miraculeuse, ce paradis terrestre où fêtes et bombances sont perpétuelles, où l'on prône le jeu et la paresse plutôt que le travail acharné.Par l'entremise de Monsieur et Madame Dévaud, les parents de Marie-Jo, j'ai fait la connaissance d'un banquier, Monsieur Arnaud. Je le voyais à l'occasion, quand il venait manger au Guillaume Tell. Il s'intéressait aux chevaux et mon futur beau-père en possédait quelques-uns. Il élevait même des chevaux de course. Il lui a acheté une jument, Morzan, pour quelques mille francs. Il a emmené sa bête courir à l'hippodrome d'Yverdon-les-Bains, entre autres. Mais elle ne rapportait même pas de quoi couvrir les frais qu'elle occasionnait.
Monsieur Arnaud et moi sommes devenus copains. On parlait régulièrement de notre sujet favori, les chevaux.
- Ça ne va pas cette jument, elle ne vaut rien !
- C'est vrai, elle est pas terrible.
- Il faut acheter un autre cheval !
Il voyait grand, Arnaud. Il avait l'intention d'acheter en France, de pouvoir faire monter une bête sur territoire français, et de suivre les règles strictes édictées par les PMU, le Pari Mutuel Urbain. Un jour il arrive en disant :
- J'ai trouvé un cheval !
- Ah oui bien !
- Oui, il coûte deux cent mille francs !
- Ah quand même !
- Oui, mais je ne veux pas l'acheter à mon nom, ma situation ne me le permet pas.
- Oui, je comprends !
- J'ai besoin de toi pour fonder une société !
Devant un notaire, il fallait mettre de l'argent. Nous avons investi chacun trente-cinq mille francs. Comme mes finances battaient de l'aile, je me suis dit pourquoi pas, tentons le coup ! Et nous avons acheté ensemble ce cheval. Il débute à Vincennes, un des plus grands hippodromes de France. Le cheval restait chez son ancien propriétaire, Maison Dubois et Fils, en pension pour mille cinq cents francs par mois. Nous avons fait le voyage plusieurs fois, pour voir notre cheval, chez les Dubois, une bonne entreprise, solide, longue expérience dans les chevaux de course. C'est après deux ou trois mois que l'animal était finalement inscrit pour courir, il avait suivi l'entraînement adéquat.
Nous avions pris l'avion à Belp, un voyage qui coûtait à l'époque mille francs par personne, une caravelle tellement bruyante qu'on ne s'entendait pas parler. Aller et retour le même jour, destination Orly.
Première course, il gagne, il nous a rapporté quarante-cinq mille francs. Ravageur du Rocher, c'était le nom du cheval, dans ce monde, tous les chevaux nés la même année porte un nom qui commence par la même lettre, ici un R. Nous commencions à sourire, malgré que la dette s'élevait encore à cent soixante mille francs.
Deuxième course, deux semaines plus tard, à Vincennes, il gagne, encore une fois quarante-cinq mille, la dette diminuait. C'était presque un éléphant, entier, il n'avait pas été coupé, un étalon que nous appelions affectueusement Mammouth. Monsieur Dubois nous soutenait que notre bête pouvait aller loin, très loin.
Troisième course, il gagne, cinquante mille. Nous commencions à sérieusement sourire, notre affaire allait grand train, c'est le cas de le dire.
Quatrième course, il gagne, cinquante mille. Le cheval était pour ainsi dire payé. Nous nous frottions déjà les mains. Quel filon nous avions là.
Cinquième course, Ravageur du Rocher se tord le genou. Nous avons dû prendre la décision de l'abattre.
Cette expérience a été fantastique. Passer sous l'enseigne en forme d'arche "Entrée des propriétaires", regarder la course depuis une loge toute vitrée, où il y avait à boire et à manger à discrétion, mais oui à l'œil, du champagne, du Dom Perignon s'il vous plaît, le meilleur. De plus, nous avons gagné quelque argent en pariant.
Quand Ravageur du Rocher est mort, je suis sorti de la société et Monsieur Arnaud m'a rendu mes trente-cinq mille francs. Il est resté seul maître à bord de l'"Écurie des As", c'était le nom qu'on lui avait donné. Pour moi l'histoire épique et hippique était terminée.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 26 Décembre 2013 à 07:49
 Après ce voyage, un jour, comme tout allait bien, Marie-Jo me dit :
Après ce voyage, un jour, comme tout allait bien, Marie-Jo me dit :- Francis, je veux te demander quelque chose ?
- Et bien dit !
- Tu ne crois pas qu'on devrait officialiser notre union ? Tout va bien chez toi, les affaires, nous !
- Qu'est-ce que tu entends par là !
- Moi, j'aimerais bien me marier avec toi !
Je faisais un peu la sourde oreille. J'avais déjà convolé deux fois, je n'étais pas trop intéressé de remettre ça. Depuis huit ans, nous vivions ensemble et ça allait assez bien comme cela. Mais voilà, ce que femme veut ! Vu son insistance, j'ai cédé. Il fallait entreprendre les formalités d'usage, demander un certificat d'origine à l'Officier d'État-civil de Villaraboud pour moi et de Villaz-St-Pierre pour Marie-Jo. C'est Madame Morel, Officière d'État-civil de Romont qui a publié les bans. Nous avons été "pendus" durant deux ou trois semaines. Je me souviens de ce jour, il fallait deux témoins. J'avais choisi Gérald Jordan, Syndic de la Commune de Romont, au sommet de sa splendeur qui était accompagné de sa femme Anna née Inzaghi, une remarquable pianiste, et Marie-Jo avait choisi une de ses cousines qui était accompagnée de mon ami Conrad Brodard. Nous voilà les six dans la salle des mariages.
- Francis Mauron, voulez-vous prendre pour épouse Marie-Josée Vionnet née Dévaud ici présente ?
- Ouais !
Ce n'était pas un oui franc, j'ai hésité un peu et j'ai dit ouais ! C'est là que Madame Morel me dit :
- Monsieur Mauron, pas si convaincu que cela ?
- Oui, je suis d'accord.
- Madame Marie-Josée Vionnet née Dévaud, voulez-vous prendre pour époux Francis Mauron ici présent ?
- Oui.
Cela a été un beau oui retentissant. Ça s'est passé à onze heures le matin. À onze heures et demie, l'affaire était classée.
J'avais réservé chez Girardet, le fameux restaurant, un des meilleurs du monde, à Crissier près de Lausanne. Je le connaissais déjà. Avec les fans de Gottéron, ou pour les affaires, j'avais déjà fréquenté ce lieu magique. Freddy avait appris que c'était mon dîner de mariage. Quand nous sommes arrivés, l'accueil a été à la hauteur du maître des lieux. Apéritif au champagne dans un petit salon puis repas à une table de fête de l'établissement. Vers seize, comme c'était la coutume chez lui, je suis allé payer le repas dans le petit local où se trouvait la caisse. "Cartes de crédit non acceptées", il voulait que le client paie cash. Ça m'a coûté pour les six convives mille huit cents francs, aujourd'hui je suppose que cela coûterait le double, au moins. Jolie fête. Nous sommes rentrés, rendez-vous à Villarsiviriaux. C'est là que j'ai reçu une œuvre d'art de Louis Sugnaux, ferronnier d'art à Billens près de Romont. C'est finalement mon ami Conrad qui a payé le cadeau pour tout le monde, quatre mille francs, il dit que ça lui a coûté.
Le mariage ayant été déjà consommé, la vie a continué. Nous étions mariés, nous étions bien ensemble, j'ai construit une magnifique piscine dans mon château après avoir loué pour huit mille francs pour un mois, une villa au Tessin, en dessus de Locarno. J'ai toujours fait des calculs et là je me suis dit, au lieu de payer un tel prix, je vais faire une piscine à la maison.
Marie-Jo avait deux filles, Delphine et Christine, et moi j'avais mes deux garçons. Chaque deux semaines le vendredi, c'était devenu un rituel, j'allais chercher les deux filles à Châtel-St-Denis. C'est le père qui en avait eu la garde, vu qu'elle avait un comportement un peu irresponsable. Puis j'allais prendre mes deux garçons à Chavannes-sous-Romont où Elisabeth avait construit une maison avec son nouveau mari. Nous avons passé là de belles années, l'entente était belle. Les deux filles avaient quatre ou cinq ans de plus que mes garçons. Le samedi matin, il fallait faire les courses pour nourrir toute cette jeunesse. Nous nous rendions à Avry Centre. Un billet de cinq cent balles y passait, mais moi je ne faisais rien, j'attendais au bistrot qui se trouvait au milieu du centre commercial. Il fallait bien cela pour six coqs en pâte, pour deux jours. Et le dimanche soir, je ramenais chacun chez eux. Je me souviens de cette époque avec nostalgie. J'avais acheté un but de football et je jouais avec mes deux garçons et même avec les filles, une équipe de cinq, c'était une belle partie de rigolade. Marie-Jo nous regardait.
Les vacances, c'était toute une histoire, il fallait prendre deux voitures pour emmener tout ce petit monde. Un jour, la veille de partir, Pierre-Yves mon fils aîné se casse le bras. Il a fallu le laisser là pour qu'il se fasse soigner. Un semaine plus tard, je suis revenu du Tessin pour ramener mon fiston, j'ai fait le trajet avec Marie-Jo. Sur l'autoroute, du côté de Biasca, contrôle de vitesse, je roulais à cent huitante à l'heure alors que c'était limité à cent trente.
- Vous êtes pressé Monsieur Mauron ?
- Oui, je suis pressé !
- Mais pourquoi ?
- Je vais chercher mon fils qui s'est cassé un bras il y a une semaine et à cause de cela il n'a pas pu venir en vacances dans votre beau canton.
- C'est une bien triste histoire. Alors allez-y.
Ils ne m'ont pas collé d'amende, par contre ils ont envoyé un rapport au Canton de Fribourg. Par précaution, j'avais consulté un avocat de mes connaissances, histoire de savoir à quelle sauce j'allais être mangé. Mon dernier retrait de permis datait de dix-neuf ans auparavant. Mais il valait mieux intervenir auprès de la Commission des retraits de permis avant qu'elle ait rendu son jugement. Il fallait expliquer l'histoire de l'accident de Pierre-Yves, mettre l'accent sur la tristesse ressentie de ne pas l'avoir eu avec nous toutes les vacances. Toutes ces considérations m'ont coûté mille francs, cinq cents francs la page. Et là, miracle, deux semaines après, j'ai reçu un avertissement simple avec cinquante francs de frais à ma charge, pas de retrait de permis. J'ai payé avec plaisir les mille francs alors que ces cinquante kilomètres de plus m'auraient valu au moins trois mois de retrait. Quelle aubaine !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 26 Décembre 2013 à 07:46
 A cette époque, des ingénieurs ont envoyé à l'entreprise Mauron une invitation à soumissionner pour la construction d'un silo à blé à Vauderens, silo qui servirait à entreposer le blé. Au moment de vendre ce blé à des moulins, ce n'était plus chaque paysan qui allait négocier, mais la société, la quantité était importante donc le prix bien plus intéressant.
A cette époque, des ingénieurs ont envoyé à l'entreprise Mauron une invitation à soumissionner pour la construction d'un silo à blé à Vauderens, silo qui servirait à entreposer le blé. Au moment de vendre ce blé à des moulins, ce n'était plus chaque paysan qui allait négocier, mais la société, la quantité était importante donc le prix bien plus intéressant.Nous avons fait la meilleure offre. Le silo devait être construit en béton armé, par un coffrage grimpant, ce qui veut dire qu'au fur et à mesure que nos le remplissions de béton, le mur montait. Cela a duré quatorze jours et nous travaillions vingt-quatre heures sur vingt-quatre, deux fois douze, des équipes de douze heures. Nous avions sollicité une autorisation à la Préfecture ainsi qu'à la Commune et à la Paroisse, autorisations qui avaient été accordées.
La technique de construction n'existait pas encore en Suisse. Nous avions pris contact avec une entreprise allemande de Stuttgard pour savoir comment monter un silo. C'est un chef de chantier qui est arrivé avec le matériel de coffrage nécessaire, assez primitif en soi mais qui avait bien fonctionné. Cet allemand nous reprochait d'ailleurs d'être Griechenland, ce qui voulait dire que nous avions des procédés de grecs.
L'auberge du Chamois de Vauderens était restée ouverte vingt-quatre heures sur vingt-quatre pour toute la durée des travaux. Maguy, la Patronne, une femme accorte et qui aimait bien séduire, se faisait un plaisir de nous recevoir, c'est elle qui était de garde durant la nuit. Dans l'arrière-salle, des alcôves pourraient bien raconter quelques histoires, mais rien de bien répréhensible ni méchant. Nous aimions surtout passer du bon temps à boire quelques bonnes bouteilles, à refaire le monde en la draguant un peu. Et comme le tiroir-caisse fonctionnait bien, tout le monde y trouvait son compte.
Arrive le jour de l'inauguration. Le Président de la Société d'Agriculture, Louis Périsset, le grand Chef omnipotent de la société, Maurice Braillard, et surtout les filles de la Société de Jeunesse étaient là. Le sapin et les filles étaient tout enguirlandés. Après le souper de circonstance, au restaurant du Chamois bien entendu, un petit orchestre s'est mis à jouer et nous avons dansé. Une fille me toisait, me reluquait depuis le début de la soirée, c'était la maîtresse d'école, Canisia Oberson. Il y avait entre elle et moi comme une étincelle, une lueur qui pouvait laisser présager que la soirée finirait tard et bien. Le but non avoué, l'idée qui naviguait entre les yeux, le coeur et le pantalon, était bien sûr de finir par toucher la demoiselle, et de lui rendre hommage même.
À la fin du bal, vers trois heures du matin, Maurice et moi sommes allés boire le café noir chez la Maîtresse d'école, à son appartement, en-dessus de l'école. Et là, ce fut le combat des chefs pour savoir qui resterait avec la demoiselle. J'avais un avantage certain, je vivais à l'extérieur, tandis que Maurice habitait à cinquante mètres de l'école. Sa femme avait un magasin d'alimentation, c'était une personne publique. Difficile dans ces conditions de tenir la place. À cinq heures du matin, Maurice est parti. J'ai pu enfin prendre dans mes bras la demoiselle aux yeux de biche.
Le lendemain matin, le Président de la Commission scolaire téléphone à Canisia pour lui signifier qu'il n'y avait pas école ce jour-là. C'est vrai qu'il avait énormément neigé. Les enfants déjà arrivés étaient en train d'enlever la neige sur ma belle voiture. Ils sont partis.
Je suis rentré chez moi à dix heures du matin, prétextant une embardée dans un fossé. J'avais soi-disant dû appeler les paysans du coin pour me sortir de là et ils m'avaient gentiment suggéré de ne pas reprendre le volant dans mon état d'ébriété avancé. J'avais écouté leurs sages conseils. Je ne me suis jamais posé la question de savoir si elle m'avait cru.
Quand ils ont construit le deuxième silo de Vauderens, ce n'est pas à moi qu'on a adjugé les travaux. C'est une soirée qui finalement m'a coûté très cher. Je ne regrette rien.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 11 Octobre 2013 à 11:53
 C'est cette même Sœur Préfète, Isabella Muller qui a reçu la lettre réponse de mon père, lorsque l'établissement voulait me mettre dehors parce que j'étais trop exigeant, que l'établissement n'était pas à la hauteur de mes désirs et que je n'acceptais pas les conditions. Mon père a téléphoné à la religieuse qui me l'a passé et là, j'ai confirmé ce que j'avais à leur reprocher. Mais mon père n'était pas d'accord, il n'a pas appuyé ma révolte. Dans sa lettre, il relevait les faits que des générations de Mauron avaient étudié là, qu'il était syndic et député, qu'il était un homme en vue, que ça ferait vraiment vilain dans le décor de voir son fils se faire renvoyer du pensionnat. C'était impossible pour lui. Il s'est mis à plat ventre devant la Sœur Préfète, peut-être a-t-il même oublié quelques billets de banque dans l'enveloppe.
C'est cette même Sœur Préfète, Isabella Muller qui a reçu la lettre réponse de mon père, lorsque l'établissement voulait me mettre dehors parce que j'étais trop exigeant, que l'établissement n'était pas à la hauteur de mes désirs et que je n'acceptais pas les conditions. Mon père a téléphoné à la religieuse qui me l'a passé et là, j'ai confirmé ce que j'avais à leur reprocher. Mais mon père n'était pas d'accord, il n'a pas appuyé ma révolte. Dans sa lettre, il relevait les faits que des générations de Mauron avaient étudié là, qu'il était syndic et député, qu'il était un homme en vue, que ça ferait vraiment vilain dans le décor de voir son fils se faire renvoyer du pensionnat. C'était impossible pour lui. Il s'est mis à plat ventre devant la Sœur Préfète, peut-être a-t-il même oublié quelques billets de banque dans l'enveloppe. C'est là que j'ai été convoqué un soir au parloir. Sœur Isabella Muller était rouge de colère. Elle m'a insulté, m'a humilié, m'a agonisé durant une demi heure, à genoux devant elle. Je pleurais à chaudes larmes. J'ai été anéanti.
- Maintenant tu pries deux dizaines de chapelet avec moi !
- Ton papa est quelqu'un de bien, alors nous avons décidé de te garder.
- Mais tu comprends bien qu'il faudra changer ta manière de voir les choses, sinon nous allons encore avoir des problèmes toi et moi.
Depuis lors, j'ai appris à pratiquer la condescendance, voir l'obséquiosité. Je ne pouvais pas être moi-même, dire ce que je pensais, faire un peu l'anarchiste. Non, je devais me plier aux règles, condescendre. Je passais devant la chapelle cinq ou six fois par jour, et chaque fois, je m'inclinais légèrement et disait d'un ton mesuré :
- Grüss Gott Schwester, Grüss Gott Schwester !
Toute la sainte journée, je baisais la tête et répétais :
- Grüss Gott Schwester, Grüss Gott Schwester !
Et petit à petit, je suis devenu le roi ...
- Ah mais Francis, qu'est-ce qu'il a changé ! C'est magnifique, bravo !
- Tu n'aimes pas trop le chant, et bien n'y va pas, tu peux rester à la salle d'étude.
J'avais des tas de petits avantages que j'appréciais beaucoup, alors que six mois auparavant, j'étais pratiquement l'homme à abattre. J'avais joué le jeu et je faisais beaucoup plus ce que je voulais que lorsque je prenais les choses de front. La vie m'a offert là une belle leçon de diplomatie, enfin si on peut dire ...
Le théâtre m'a vraiment procuré un grand plaisir. Bien sûr, il y avait celui des filles et celui des garçons et aussi celui des alémaniques et celui des français, malgré cela, j'ai aimé en jouer. Quant à Sœur Pierre-Marie qui nous aidait pour les répétions le soir à sept heures et demi huit heures, elle nous apportait beaucoup par son comportement enthousiaste et généreux et je l'aimais bien. Là nous avions le plaisir de parler notre propre langue.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 15 Juin 2013 à 19:06
 On sort un matin, et je m'approche des taxis. C'est là que je retrouve mon chauffeur de taxi du premier jour.
On sort un matin, et je m'approche des taxis. C'est là que je retrouve mon chauffeur de taxi du premier jour.- Tu sais où habite le Père Léon ?
- Oui, bien sûr !
- Et bien emmène-nous chez le Père Léon !
- D'accord.
Après une quinzaine de kilomètres, nous arrivons devant une grande église.
- C'est là, c'est l'église du Père Léon !
- Il est là ?
- Non, non, il habite à la cure, c'est un peu plus loin !
- Dépose-nous chez lui, et tu viendras nous rechercher, on t'appellera!
- D'accord.
Le Père Léon était là, avec sa bure brune, son cordon à la taille et ses sandales, une longue barbe fleurie. Mais il n'était pas seul. Il y avait une vingtaine de personnes, la majorité de jeunes filles, qui vivaient là, au service de l'église et du Père Léon.
- Salut Père Léon !
- Hello, who are you ?
- Mais, tu ne me reconnais pas ?
- No, no ...
- Je suis Francis, un Mauron de Villaraboud, fils de François !
- Ah ! Ah ! Francis ! Mais bien sûr !
Ils nous a invités à rentrer et à s'assoir. J'ai dit :
- Alors ça va cet apostolat ?
- Oui, oui, ça va, des fois c'est difficile !
- Non mais, attends, tu as vu ce qu'il y a autour de toi ? Ça ne m'a pas l'air trop difficile à convertir, ces païens.
- Il faut leur apprendre, Jésus, le nouveau testament, tout cela.
Il faut dire que les franciscains aimaient bien se démarquer de l'Église Catholique avec laquelle ils avaient parfois des divergences d'opinion.
- Tu catéchises alors ?
- Oui, tous les matins, je donne des leçons, spécialement sur le Nouveau Testament.
- Et ils comprennent ?
- Oui, oui, ils sont intelligents, illettrés mais intelligents, ils comprennent bien !
- C'est quoi cette église ?
- C'est moi qui l'ai construite !
- C'est pour ça que tu étais venu faire l'aumône, à Villaraboud et dans les paroisses environnantes ?
- Oui, bien sûr !
Elle était belle son église, genre un peu néogothique, avec son beau clocher, un peu bon enfant, mais jolie !
- Dis-moi Père Léon, quand tu es venu avec ton film de lions et de tigres, et ta forêt vierge, tu nous en as raconté ? Il y en a des bêtes sauvages ?
- Oui, on peut aller faire un tour.
C'était une forêt gentillette, sans danger pour l'homme. Je n'y ai même pas vu une fourmi.
- Tu nous en as raconté de bien belles ?
- Mais oui, tu vois, il fallait bien trouver l'argent !
- ...
Nous avons dormi à la cure du Père Léon. Le lendemain, nous l'avons quitté.
Fin des vacances, retour en Suisse. Je me souviens encore de l'escale entre Nairobi et Paris. L'avion était bien rempli et Élisabeth et moi n'étions pas assis l'un à côté de l'autre. Sur un banc de trois, j'avais la place du milieu. Côté hublot, une matrone noire d'au moins cent vingt kilos et à droite une autre femme noire, un peu plus légère, mais quand même, nonante kilos. Moi au milieu, heureusement que j'étais mince, ça dure quand même sept heures, Nairobi Paris. Personne ne disait rien, on a mangé, j'ai bu quelques whisky. Après deux ou trois heures, la dame du hublot s'est endormie et sa tête est tombée sur mon épaule, elle se cramponnait à moi. J'ai tenté de la remettre à sa place, délicatement, peine perdue, elle est restée endormie durant une heure puis elle s'est réveillée et m'a regardé avec ses grands yeux noirs, l'air à peine gêné.
Quant au Père Léon, après trente ans d'apostolat, après de bons et loyaux services, sa hiérarchie lui demanda de rentrer au pays pour vivre une vieillesse heureuse.
Mais, le père Léon refusa, comme je le comprends.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 4 Mai 2013 à 06:38
Tiré du livre "Le dernier chantier"
biographie de Francis MauronCela se passait à la Guglera, un institut pour jeunes gens et jeunes filles de bonne famille du Canton de Fribourg, dans les années septante.
Le reste de l'année, après le premier mois, nous avions l'obligation de parler la langue que nous étions venus apprendre tous les jours de la semaine, sauf le dimanche. Pour celui qui dérogeait à cette règle, un système machiavélique avait été mis au point par les frangines, c'est le système des médailles.
Celui qui était pris en flagrant délit de parler sa langue, dénoncé par un de ses camarades, la délation allait bon train, celui-là recevait une médaille et la gardait dans sa poche. Chaque jour à midi, celui qui avait une ou plusieurs médailles dans ses poches devait payer vingt centimes par médaille. Trente à quarante médailles circulaient ainsi. Quand nous, les romands avions hérité d'une médaille, nous tentions de la refiler à un suisse allemand et eux, bien sûr agissaient de même.
- Oh ... Du hast deutsch gesprochen ! Paf ! Une médaille dans sa poche.
- Ach ... Tu as parlé le français ! Paf ! Eine Medaille in meiner Tasche !
Ça se passait durant la promenade. C'était assez cruel comme système, surtout venant de gens de Dieu qui incitaient ainsi de jeunes personnes à la délation ... On peut aussi voir cela comme un jeu. Si tu gardais la médaille durant plusieurs jours dans ta poche, tu payais chaque jour vingt centimes.
Il y avait en ce temps-là à La Guglera un suisse allemand qui se nommait Stöckli, une espèce d'angelot en pantalon golf, petit de taille, gentil, issu d'une famille riche de Zoug. Il n'arrivait pas à refiler ses médailles et il se faisait prendre sans cesse à parler allemand. De plus, il avait un problème d'énurésie. Il vivait dans mon dortoir, numéro quatorze où nous étions sept. Durant la nuit, les bonnes soeurs se faufilaient dans la chambre, silencieusement, changeaient le linge de son lit et repartaient. Nous l'aimions bien, c'était un bon type. Il avait toujours cinq ou six médailles sur lui ce qui fait qu'il a dû payer, durant les trois mois de son séjour, moins le premier mois, une assez coquette somme à l'Institut. Il se faisait massacrer, pauvre garçon.
Finalement, il a dû parler du procédé à ses parents, puisqu'il n'est plus revenu.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 13 Mars 2013 à 08:45
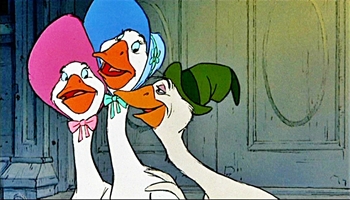 Mon oncle André, menuisier, habitait une bâtisse située entre notre maison et la ferme de l'oncle Henri. Paletot et sa famille habitait en face, de l'autre côté de la route. Un jour, nous avons entendu dans les branches que l'oncle André était parti avec sa femme rendre visite à son beau-frère, médecin de son état, à Lausanne. Nous voilà, les éternels trois compères, avec notre goût de l'aventure aiguisé, surtout de savoir que la maison de mon oncle était sans surveillance.
Mon oncle André, menuisier, habitait une bâtisse située entre notre maison et la ferme de l'oncle Henri. Paletot et sa famille habitait en face, de l'autre côté de la route. Un jour, nous avons entendu dans les branches que l'oncle André était parti avec sa femme rendre visite à son beau-frère, médecin de son état, à Lausanne. Nous voilà, les éternels trois compères, avec notre goût de l'aventure aiguisé, surtout de savoir que la maison de mon oncle était sans surveillance. La cave était facilement accessible et ce n'est pas un carreau de fenêtre qui nous arrêtait. La vitre cassée, nous nous sommes introduits dans le sous-sol, il devait bien y avoir quelque chose à chaparder. Je ne sais plus qui avait les idées lumineuses, il me semble bien que c'était mon frère. Elle était bien garnie cette cave. Dans un casier, avec l'inscription "Malaga", nous nous sommes servis, à chacun sa bouteille et nous avons quitté les lieux.
Assis sur la bas-côté de la route qui va vers Chavannes-les-Forts, nous avons commencé à "siffler" notre vin de Malaga, sans réaliser vraiment ce qui allait nous arriver, nous allions prendre notre première cuite. Lorsque tout a été vide, nous avons tenté de nous relever de notre talus :
- Ça ne va pas, dit Paletot.
- Quoi, qu'est-ce qui se passe ?
- Ça ne va pas ...
- Maintenant, on va jusqu'au bout, dit mon frère !
- Quoi, jusqu'au bout de quoi ?
- On va au bistrot !
Arrivés devant le bistrot du village de Chavannes-les-Forts, Paletot avait très très soif. Il se penche à la fontaine pour boire de l'eau. Plouf ... Il tombe dans la fontaine la tête la première. Il était en train de se noyer lorsque je l'ai récupéré. Et nous sommes entrés dans l'établissement. Jouer au foot foot, première tentative, impossible, nous ne tenions pas sur nos jambes.
- Rentrez chez vous, bande de gamins, avant que je n'appelle le gendarme, nous dit le cafetier qui avait tout de suite remarqué notre état d'ébriété aussi inhabituel qu'avancé !
- D'accord, on s'en va !
Une fois dehors, nous avons voulu continuer notre périple éthylique ... Il existait, au fond de Villaraboud, un estaminet, chez tante Thérèse, épouse de mon oncle Calixte.
- Un demi de blanc, nous avons commandé sur le ton hautement péremptoire de ceux qui manquent d'autorité.
- Non mais, vous vous êtes regardés, vous êtes déjà complètement saouls !
- On a des sous, on veut boire un demi de blanc !
Les sous, c'est connu, ça fait changer d'idée... J'ai mis deux francs sur le comptoir. Le demi nous a été servi. Puis nous sommes sortis et avons pris la direction de nos foyers à deux ou trois cents mètres de là. Mon frère ne disait plus rien. Paletot déconnait à pleins tuyaux. Un tracteur agricole se pointe à l'horizon et arrive en face de nous. Mon ami Paletot se met au milieu de la route :
- Quarante francs, quarante francs !
- Quoi quarante francs, tu lui veux quoi ?
- Quarante francs d'amende ! Tu n'as pas le droit de circuler la nuit avec ton tracteur !
Le paysan s'est arrêté et a essayé de tempérer. Quand il a vu notre état, il a dit :
- D'accord, on discutera une autre fois, quand vous aurez posé votre cuite !
- Quarante francs, quarante francs, continuait Paletot ! Il n'a pas le droit, c'est nuit ! Il roule sans phare ! Quarante francs !
Il est rentré chez lui à quatre pattes.
Mon frère et moi sommes allés directement dans notre chambre, nous mettre au lit. Au milieu de la nuit, je sens quelque chose de chaud dans mon oreille. C'était mon frère adoré qui vomissait sur moi ... malade comme un chien. D'ailleurs, le lendemain quand il s'est présenté à l'école, blanc comme un linceul, l'instituteur l'a renvoyé aussi sec !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 9 Janvier 2013 à 16:49
C'est ainsi que Robert est allé accompagner sa fille à la maternité. Je me souviens d'avoir traversé les villages en direction de Romont à au moins cent cinquante à l'heure. J'ai juste eu le temps d'arriver que, quelques minutes après Pierre-Yves, mon premier fils était là. Je n'avais pas eu le temps de me faire du mauvais sang. J'ai assisté aux dix dernières minutes, à la tête du lit où se trouvait ma femme, dans les douleurs de l'enfantement.

- Pousse, pousse ... c'est tout ce que je trouvais à dire. J'étais quand même dans mes petits souliers !
- Ouah ... ouah ...
- It's a boy, j'ai dit. D'ailleurs elle m'en a fait le reproche un peu plus tard. Pourquoi parler en anglais ?
- Monsieur Mauron, il faut sortir, on va finir de s'occuper de votre femme, a dit le médecin. Il faut vous rendre chez l'aumônier pour l'enregistrement.
J'arrive au bureau qu'on m'avait indiqué et là se trouvait déjà l'Officier d'état civil, pour prendre acte de la naissance de ce nouvel être.
- Monsieur Mauron, toutes mes félicitations, dit-il.
- Vous allez bien ? Me dit l'aumônier.
- Un peu remué, un peu remué ! Je ne devais pas avoir la mine du vainqueur.
- Il vous faut un bon remontant !
- Oui, c'est une bonne idée !
Il m'a versé un gros verre de cognac.
Après les écritures d'usage, je suis retourné auprès de ma femme. Nous avions convenu ensemble du prénom de notre premier enfant. Nous avions pensé à François, pour faire plaisir à mon père, mais j'étais contre. À chacun son prénom, à chacun son identité. Ma femme avait une préférence pour les prénoms doubles, ainsi ce fut Pierre-Yves.
Après trois ou quatre jours, nous étions rentrés chez nous, nous habitions encore à la route d'Arruffens douze.
Je n'osais pas prendre dans mes bras ce petit être d'une semaine, j'avais peur de le casser. Je le regardais de loin. Je n'osais même pas le toucher. Ma femme n'a pas pu le nourrir au sein, c'est le lait Guigoz qui a permis de nourrir mon fils.
Élisabeth était une bonne mère, elle prenait grand soin de son cher fils. Et moi je me suis senti un peu mis de côté. C'est chaque fois pareil, l'amour, la vie de couple, la belle vie et voilà qu'arrive l'enfant et le mari passe au second plan. À cause de ma maladresse, à cause de l'attention que ma femme donnait quasi complètement à son fils, j'allais me consoler au bistrot, souvent à l'Hôtel de la Gare à Romont. Je n'ai jamais cessé de regarder les autres femmes, c'était plus fort que moi. Le samedi après-midi, je jouais aux cartes avec les copains et quand je rentrais, je disais :
- Alors il va bien ?
- Oui il va bien, ce n'est pas pour ce que tu t'en occupes, mais il va bien.
- Mais tu sais bien, je n'ose pas.
J'avais peur de le casser.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 18 Novembre 2012 à 08:38
Après que la grand-mère ait été enterrée, avec tous les honneurs qui lui étaient dus, j'ai assisté à une drôle de scène.
 Remue-ménage dans la maison. Mon père et ma mère étaient invisibles. Mes oncles et mes tantes, frères et soeurs de mon père, arrivaient les uns après les autres. Ils grimpaient immédiatement l'escalier qui menait au premier étage, avec une mine renfrognée de circonstance, direction la chambre de feu ma grand-mère. J'étais avec la servante, Suzanne Morel, une gentille fille. Je l'avais invitée un jour au cinéma, elle avait refusé. Nous nous étions mis à couvert, derrière un tas de bois, d'où on entendait tout ce qui se disait dans la chambre du premier étage.
Remue-ménage dans la maison. Mon père et ma mère étaient invisibles. Mes oncles et mes tantes, frères et soeurs de mon père, arrivaient les uns après les autres. Ils grimpaient immédiatement l'escalier qui menait au premier étage, avec une mine renfrognée de circonstance, direction la chambre de feu ma grand-mère. J'étais avec la servante, Suzanne Morel, une gentille fille. Je l'avais invitée un jour au cinéma, elle avait refusé. Nous nous étions mis à couvert, derrière un tas de bois, d'où on entendait tout ce qui se disait dans la chambre du premier étage.C'était un événement particulier pour nous, dans ce village où il ne se passait pas grand chose. Un palabre digne du nom, on pourrait même aller jusqu'à dire une bataille de chiffonniers. D'abord il y avait une table, Louis XV ou un de la lignée :
- Qui veut la table ? Toi François, tu es l'aîné, tu peux choisir en premier !
- Non, non, je ne veux rien !
Grande discussion entre l'oncle Henri et l'oncle Ernest pour la table.
- C'est moi qui y ai droit !
- Non, moi je me suis plus occupé de maman que toi !
Et patati et patata !
La table a finalement été adjugée à l'oncle Ernest. Ensuite, les six chaises, à qui allaient revenir les chaises assorties à la table ? Henri dit :
- Je veux les chaises.
- Non, rétorque l'oncle Raymond, je suis plus vieux que toi, c'est moi qui ai droit aux chaises.
- J'ai toujours bien aimé maman, et je veux ses chaises, insiste Henri.
De vrais chiffonniers, je vous disais. C'est Henri qui a eu les chaises. Il restait un vaisselier. Il a fallu des négociations d'une bonne demie-heure pour savoir qui prendrait le vaisselier. C'était mon grand-père qui avait acquis ce meuble, lors d'une mise de l'Office des Poursuites, un client qui ne payait pas.
Louis et Calixe n'avaient encore rien dit. Ils laissaient tranquillement passer l'orage, se disant qu'ils prendraient ce qui resterait, s'il restait quelque chose. C'est l'oncle Raymond, deuxième de la fratrie, qui s'en est allé avec le vaisselier.
Calixe reçut la commode.
Louis, le dernier, n'a pas eu de meuble, il n'en restait plus à part le lit. Des bricoles, de la vaisselle, il s'est contenté de ce qu'on lui donnait. C'est un doux, Louis, c'est un doux.
Quand est venu le moment de parler du lit, mon père dit :
- Le lit, ça c'est à moi !
- Mais comment, mais comment, tu as dit que tu ne voulais rien !
- Maman est restée vivre avec nous de mille neuf cent quarante-cinq à mille neuf cent cinquante-trois, battez-vous comme vous voulez, mais le lit reste là ! Il est à moi !
- Bon, bon, d'accord, finirent par acquiescer les autres, non sans avoir charogné1 un moment.
C'était dix heures ou dix heures et demie, le soir. Suzanne et moi avons beaucoup ri dans nos mains de les entendre se disputer de la sorte.
Ils sont ressortis, les uns après les autres, et sont partis chacun de leur côté, sans se saluer.
1Utilisé en Suisse romande comme batailler, ergoter
 2 commentaires
2 commentaires
-
Par ChristianeKolly le 4 Novembre 2012 à 10:08
 Une autre manifestation étrange a eu lieu par l'intermédiaire d'une vieille machine à écrire, de marque Monarch, toute noire, avec de grosses touches et qui pesait très lourd. Elle avait été entreposée au galetas. Nous étions au lit mon frère et moi, et il se réveille :
Une autre manifestation étrange a eu lieu par l'intermédiaire d'une vieille machine à écrire, de marque Monarch, toute noire, avec de grosses touches et qui pesait très lourd. Elle avait été entreposée au galetas. Nous étions au lit mon frère et moi, et il se réveille :- Tu as entendu ?
- Quoi ? Quoi ?
- Taper à la machine !
- Et bien oui, j'ai entendu !
Nous en avons parlé à notre père qui d'abord a encore minimisé, mais s'est finalement rendu compte que la Monarch faisait du bruit. Mais comment agir pour faire cesser ce tapage, ça commençait à coûter cher tout cela. Il a demandé à sa mère :
- Croyez-vous que son âme vagabonde toujours ?
- Oui, c'est possible !
Là, c'est mon père qui a rendu visite aux Capucins de Romont, ces franciscains à la bure brune, corde blanche et sandales. Il est allé voir le chef, Père Joseph Marie et lui a raconté cette histoire de machine à écrire.- Après une nuit de réflexion, j'y verrai plus clair, reviens demain ! Dit le Père Joseph Marie.
- J'ai trouvé la solution, lui dit-il, le lendemain.
Il est venu à la maison, avec le matériel nécessaire, crucifix, eau bénite, etc. et il a récité des paroles en latin, une sorte d'exorcisme, en fait. Ça nous a de nouveau coûté cent balles. Et ce deuxième problème a été réglé, l'âme d'Ernest semblait en paix. votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 4 Novembre 2012 à 10:02
 Mais Boby ne pouvait pas s'empêcher de faire son numéro. Avant le dîner, le repas du soir, puisqu'ici en Suisse on dirait souper, nous allions prendre un verre au bar. Il y avait là plusieurs jeunes hommes, employés de l'hôtel courtois et avenants, qui la trouvaient bien jolie. Toujours prête à tester son pouvoir de séduction, elle jouait des yeux, des bras, des jambes, de tout son corps. La mini jupe qu'elle portait parfois, courte à la limite de la décence, attirait les regards masculins sur ses jambes. Elle zieutait à gauche, elle zieutait à droite. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit !
Mais Boby ne pouvait pas s'empêcher de faire son numéro. Avant le dîner, le repas du soir, puisqu'ici en Suisse on dirait souper, nous allions prendre un verre au bar. Il y avait là plusieurs jeunes hommes, employés de l'hôtel courtois et avenants, qui la trouvaient bien jolie. Toujours prête à tester son pouvoir de séduction, elle jouait des yeux, des bras, des jambes, de tout son corps. La mini jupe qu'elle portait parfois, courte à la limite de la décence, attirait les regards masculins sur ses jambes. Elle zieutait à gauche, elle zieutait à droite. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit !Mais le cinquième jour :
- Maintenant, tu arrêtes ton cinéma ! J'en ai marre !
- Quoi ? Je fais quoi ?
- Quand tu attends durant trois minutes, avec ta cigarette dans ta bouche rouge baiser, que quelqu'un accourt pour l'allumer, tu fais un genre un peu particulier ! Arrête ça !
- Je ne fais pas de cirque, c'est naturel !
- Je te dis d'arrêter !
- Viens, on va danser !
Nous sommes allés au dancing de l'hôtel, nous dansions ensemble, mais elle a continué à draguer, très discrètement, mais elle ne pouvait s'empêcher d'aguicher les hommes. J'étais jaloux. Je sortais ma belle jeune fille, avec ses quinze ans de moins que moi, et elle n'avait pas d'yeux que pour moi. Ça n'allait pas du tout.
J'étais excédé. Sur mon ordre, nous sommes rentrés dans la chambre. Je l'ai un peu malmenée. Je l'ai baisée sur le tapis de la chambre, sans grands ménagements, peut-être même d'une manière sauvage. Elle s'est mise à pleurer.
- Je veux écrire à mon père !
- Et bien écris à ton père !
Une fois la lettre écrite, je lui ai demandé de la voir. Je l'ai lue. Puis, je l'a déchirée.
- Maintenant tu arrêtes de faire l'enfant, tu te comportes correctement. Je vais freiner ma jalousie et toi tu freineras ton envie de séduire les hommes.
- Bon, d'accord.
La fin des vacances a été agréable. Elle s'est tenue à carreau. Retour à Genève où j'ai retrouvé mon carrosse. Retour à Romont, devant sa porte :
- Francis, c'est fini, je ne veux plus te voir.
- Mais pourquoi ? Qu'y a-t-il ?
- Ça n'ira jamais entre nous !
Bon, si c'est ce que tu veux !
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 4 Novembre 2012 à 09:58
C'est un peu plus tard qu'a eu lieu, dans les environs de Romont, l'asséchement du marais de la Praly qui se situait entre Villaraboud et Romont. C'était une espèce de grand étang, incultivable, où il y avait surtout des libellules. Quand nous, enfants, étions allés jouer dans ce marais, nous rentrions tout crottés et nous finissions enfermés à la cave pour deux heures.
Un centre d'hébergement de réfugiés politiques avait été ouvert à Romont, dans les baraquements de l'armée. Il y avait là des Polonais, des Hongrois et des gens de ce qui a été la Yougoslavie du nord, probablement des slovènes et des croates. Les pouvoirs publics, voyant tous ces jeunes gens désoeuvrés avaient décidé de les occuper et de leur permettre de gagner quelque argent.
Comme mon père était sous les drapeaux, c'est ma mère qui s'occupait de la partie financière du chantier. Le samedi après-midi, ils arrivaient tous pour "toucher" leur paie. Ils étaient jeunes et tous plus beaux les uns que les autres, polis, fantastiques.
Ces hommes aux costumes kakis ont laissé des traces dans la région, les filles tombaient amoureuses, surtout que tous les suisses étaient mobilisés. Dans les villages aux environs de Romont, ils ont fait des filles mères puisqu'ils sont tous repartis chez eux à la fin de la guerre, aucun n'a convolé en Suisse.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par ChristianeKolly le 4 Novembre 2012 à 09:56
 Le jeudi, à part patauger dans le ruisseau ou jouer aux aventuriers dans la grotte, les poletz avaient leur part. Après une année, j'en avais cent vingt à cent trente. Mes camarades qui les avaient perdues s'arrangeaient pour s'en procurer, en volant père ou mère, ou en pillant un poulailler pour aller ensuite vendre les oeufs et avec l'argent racheter des poletz.
Le jeudi, à part patauger dans le ruisseau ou jouer aux aventuriers dans la grotte, les poletz avaient leur part. Après une année, j'en avais cent vingt à cent trente. Mes camarades qui les avaient perdues s'arrangeaient pour s'en procurer, en volant père ou mère, ou en pillant un poulailler pour aller ensuite vendre les oeufs et avec l'argent racheter des poletz.Celui qui perdait et qui n'avait plus de billes recevait un gage, un devoir. Le premier décidait pour le dernier. Je me souviens du coup où j'avais donné à Paletot le gage suivant. Il avait plu durant deux ou trois jours. Au bord de la Glâne, les flaques ressemblaient plus à des lacs, avec leurs vingt mètres sur trente et au milieu une profondeur de cinquante centimètres de flotte. Mon ami Paletot a dû traverser. Il est arrivé en retard à l'école, mouillé jusqu'aux cuisses :
- Qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu es tout mouillé ? dit le maître.
- C'est à cause de Francis, il m'a fait traverser l'étang de la Glâne.
- Pourquoi il t'a demandé cela ?
- C'est à cause des poletz, j'ai perdu aux poletz.
- Vous êtes des crapauds.
C'était le cas de dire. Je crois qu'il nous comprenait.
Nous avons continué à jouer quelques mois. J'ai pratiqué les poletz de onze à treize ans. Et puis une nouvelle étape de mon éducation approchant, j'ai compté mon trésor : j'en avais trois cent soixante. Je les ai mises toutes dans un sac en jute trouvé par la baraque. Je n'allais quand même pas les distribuer aux copains. Je m'étais "crevé le cul" à les gagner. Il fallait les camoufler.
Dans le verger de mon oncle Henri, il y avait une vingtaine d'arbres fruitiers. J'ai choisi un prunier un peu à l'écart. Deux pas par ici, deux pas par là, j'avais même dessiné une carte avec la position exacte du trésor. Avec pelle et pioche, j'ai creusé un trou assez profond, cinquante à soixante centimètres, et j'ai déposé mes billes au fond du trou. Puis, après avoir recouvert mon bien de terre, j'ai soigneusement remis les mottes et arrangé l'herbe. Ni vu, ni connu.
Mais deux ans plus tard, pauvre de moi, je n'ai jamais réussi à les retrouver, l'arbre avait disparu. Les poletz sont retournées à leur état originel, elles sont redevenues terre.
Avec mon frère et mon ami Paletot, nous en avons reparlé parfois :
- Tu es un salaud Francis, tu aurais mieux fait de nous les donner.
- Tu vois Francis, tu as été puni, maintenant tu n'as plus rien.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Poésie, pain de l'invisible















